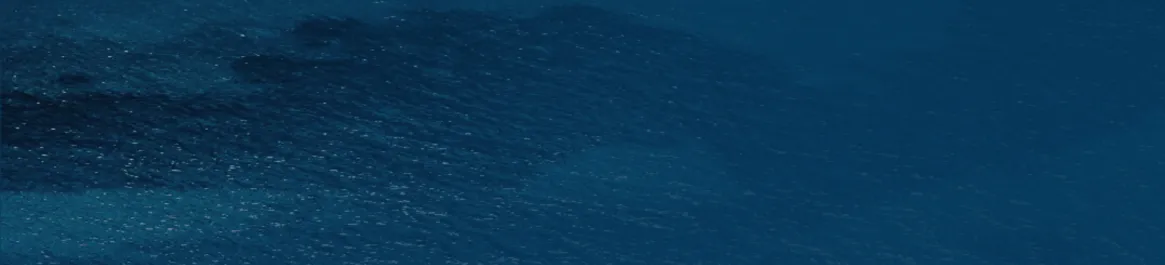
Deskiñ ha Komz Brezhoneg


Saint-Jacut de la mer - Histoire

La Tour des Ebihens
Extraits du numéro spécial de Juin 1956 de la Tanière. (Imprimé à Saint Jacut de la mer à l’imprimerie Générale de M.Lévèque9)
L’île des Ebihens (enez bihan = petite île) faisait partie du domaine de l’Abbaye. Les religieux y avaient créé une garenne, ce qui occasionna bien des « chikaïas » avec les seigneurs du voisinage qui y venaient braconner. Une chapelle y fut construite, et « à cause de cela, le port qui est tout proche, s’appelle le port de la Chapelle » (Dom Noël Mars). L’île était en partie cultivée. Une des fermières, la mère COLLET, est restée célèbre. Elle mourut presque centenaire. Le vicaire de St Jacut vint en canot lui apporter les derniers sacrements, escorté de toute la flottille des bateaux de pêche. André Theuriet, qui assistait à la scène assure que jamais il ne vit spectacle plus beau.
Les Ebihens et les îlots qui les entourent :
La Colombière (longtemps exploitée comme carrière de granit : il reste les ruines de la maison des ouvriers), Grosse (grande) Roche, Petite Roche, l’Asnelière, les Haches, Platus, les Herplus, l’île Agot, etc semblent les vestiges dun rivage disparu.
Le Donjon (1697) : construit par le comte Louis de Pontbriand, sur les plans de Vauban. « Monsieur de Vauban avait remarqué l’importance stratégique des Ebihens et jugé que cette île se trouvait propre à permettre une descente ; les ennemis peuvent en effet mouiller leurs gros vaisseaux à portée de mousquet de l’île, y faire descendre tout à leur aise pendant que la mer est haute et s’établir facilement. » ( lettre du Cte de Pontbriand, fils du précédent, au commissaire de la Marine de St Malo). Les travaux furent financés en partie par les lots de maquereaux que chaque équipage de pêcheurs des paroisses voisines devait abandonner, certains jours de l’année. Cela ne se faisait pas sans tiraillements : « Ils ne prennent rien ces jours-là par malice », se plaint le Gouverneur de l’île en 1700.
La vieille église de Saint Briac (1671) fut également reconstruite avec le produit de la pêche aux maquereaux.
Quelle fût l’utilité de la tour ? En 1732, elle ne servait qu’à monter la garde aux milices garde-côtes. En 1744, il y a 4 canons sur la plate-forme, avec affûts garnis, mais pas de munitions. L’année suivante, un canonnier de St Jacut, Guillaume Boschet, y est affecté. En 1757, on crée à la pointe nord de lîle, vis-à-vis le port du Lançon, une redoute armée de 2 canons de 12, servis par deux Jaguens : Marc Chrétien et Jacques Hesry.
Septembre 1758, débarquement des Anglais à St Briac (précédant la fameuse bataille de St Cast). Un Bénédictin, Dom Jamin raconte la défense de l’île. « Dans la matinée du 6 septembre, la flotte Anglaise vint mouiller, partie en avant de la rivière dArguenon et partie vers la Pointe de St Cast, autrement dit derrière les Ebihens. Ce fut alors qu’un petit bâtiment appelé « senau », armé de pierriers, ayant à sa suite un bateau plat chargé de soldats, voulut tenter de les mettre à terre dans l’île des Ebihens pour en faire sauter la tour. Mais Mr de la Ménardais fit alors tirer de la pointe de l’île sur ce navire deux coups de canon, dont l’un emporta son vibord et l’autre son grand foc. Le senau lui répondit dune volée de pierriers et fut essayer de nouveau de débarquer son monde dans le port de la Chapelle, mais Mr de la Ménardais l’y suivit avec ses gardes côtes et dirigea si à propos une décharge sur les troupes de transport quelles virèrent de bord à l’instant avec le senau et furent rejoindre le gros de la flotte. »
Devenu bien national, à la Révolution, l’île est achetée par un corsaire Maloin, Jean Michel. Pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire, un détachement de soldats occupe la tour. L’approvisionnement est rendu difficile par les maquis Chouans qui bloquent les routes. En 1794, le sergent-canonnier Rouxel réclame avec instance du bois de chauffage et de la chandelle. L’Amiral Gauttier-Duparc, devenu propriétaire de l’île repousse une attaque Anglaise : Cétait un Dimanche. Tous les canonniers étaient allés en permission à St Briac et à St Jacut. Soudain, venant du nord, à portée de canon, parurent trois frégates Anglaises. Elles stoppèrent et commencèrent le feu. Accompagné de sa fille Anne, l’Amiral courut vers la batterie du Nord. Bientôt, coup sur coup, il répondit aux frégates ennemies. C’était Anne, qui, de la tour, apportait les munitions. Mais les boulets des Ebihens n’allaient pas jusquaux frégates Anglaises postées près le rocher des Haches et le pertuis de Charlemagne. L’Amiral monta sur laffût d’un de ses canons pour mieux évaluer la distance : « Mon père, dit Anne, qui l’avait suivi, Je resterai tant que vous ne serez pas descendu. » Les Anglais craignant un guet-apens, leurs frégates virèrent de bord. (Herpin. Souvenir d’un bourgeois de St Malo.p.55).
A part cet épisode, aucun accrochage. Une seule victime : un canonnier qui se noya en 1817, en voulant passer à Lancieux.
Sources : études historiques et folkloriques de Saint-Jacut et ses environs (Chanoine Le Masson, Paul Sébillot) Bibliothèque du chanoine Dagorn. & Bibliothèque municipale de Dinan : Section Bretonne. * Abbé Lévèque, vicaire de St Jacut en 1956.